|
|
Haïti
|
|
|
|
||
|
Hispanolia |
 |
Christophe Colomb commence son premier voyage vers l'ouest le 3 août 1492. Il fait une escale d'un mois aux Canaries, puis, poussés par les vents alizés, ses trois bateaux traversent l'océan Atlantique. Colomb atteint les Antilles le 12 octobre 1492. Il aborde Cuba puis Haïti, qu'il nomme Hispanolia (Espagnole en latn) avant de revenir en Espagne en mars 1493. |
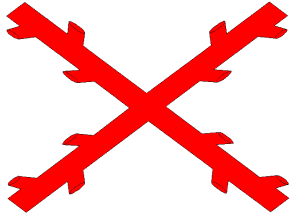 |
A son retour, le 28 novembre 1493, Christophe Colomb bâtit une nouvelle colonie sous le nom d'Ysabela en
hommage à la reine Isabelle de Castille. Cette ville est
détruite en 1502 par un cyclone et reconstruite sous le nom de Santo Domingo de Guzman, en hommage cette fois à Saint Dominique. Le nom d'Haïti vient d'Ayiti, ou Terre des hautes montagnes, nom que donnaient à l'île ses premiers habitants, de pacifiques Indiens Taïnos, du groupe des Arawaks. Tous ont disparu tragiquement en quelques années, victimes de la colonisation européenne (travail forcé, persécutions, maladies) et plus encore de l'invasion des terribles Indiens anthropophages du groupe des Caraïbes venus des îles voisines. Désireux de s'enrichir au plus vite avant de rentrer chez eux, les premiers Espagnols reçoivent des terres avec le droit de faire travailler les Indiens qui y vivent. C'est le principe du repartimiento. L'extraction de l'or dans le sous-sol et les rivières s'avère dans un premier temps très productif, jusqu'à fournir 500.000 écus d'or par an à l'Espagne. En 1507, les massacres des caraïbes et les morts causées par le travail des mines avaient réduit la population à 60 000 personnes; en une armée, dit-on, 300 000 avaient péri. En 1508, Santo Domingo devient le siège de la vice-royauté des Amériques et le centre de la colonisation espagnole. Afin de suppléer à la main-d'oeuvre indienne, les Espagnolss importèrent des esclaves d'Afrique. Commencée dès 1505, la traite fut régularisée par l'édit de 1517, autorisant l'importation annuelle de 4000 Noirs africains en Haïti. Cette immigration était indispensable à la colonie. Le dur travail des mines, bien que rémunérateur puisqu'il fournit plus de 36 millions par an et un total de près de 400, fut délaissé et n'a plus été repris; le vide se fit dans l'île quand on se jeta sur le Mexique (1520) et le Pérou (1530), dont les trésors attirèrent tous les aventuriers en quête d'une fortune rapide. En 1535, le gouverneur Nicolas Ovando fait venir des plants de canne à sucre des îles Canaries et encourage leur plantation pour compenser l'épuisement des gisements aurifères. |
|
|
Saint Domingue
|
 |
Au XVIIe siècle, des boucaniers français commencent à s'installer sur
l'île voisine de la Tortue. Eux-mêmes se dénomment pompeusement les «Frères de la côte».
Ce sont des chasseurs. Ce sont aussi des pirates et des corsaires qui
s'en prennent aux galions espagnols. Leur présence (ils sont près de
3.000) attire l'attention de Richelieu. Le 31 août 1640, les flibustiers
français expulsent leurs rivaux anglais de la Tortue et débarquent sur
le nord de l'île d'Hispaniola. |
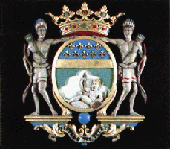 |
De son nom
officiel «côtes et îles de Saint Domingue en
l'Amérique sous le vent», la colonie devient très
vite la plus prospère des possessions françaises
d'outre-mer grâce à ses plantations de café et de
canne à sucre. À la veille de la Révolution française, Saint-Domingue assure près des 3/4 du commerce mondial de sucre ! En 1788, son commerce extérieur, évalué à 214 millions de francs, est supérieur à celui des États-Unis. La colonie compte près de 600.000 habitants, dont 40.000 affranchis, essentiellement des mulâtres, et 500.000 esclaves noirs. Les affranchis n'ont pas les mêmes droits que les colons mais bénéficient d'une certaine aisance et sont parfois même propriétaires d'esclaves. La majorité des esclaves sont nés en Afrique. Ils ont été introduits dans l'île dans le cadre de la traite, nom donné au trafic d'esclaves pratiqué par les Européens, au rythme effarant de 30.000 par an dans les années précédant la Révolution. Dans le même temps, la partie espagnole de l'île, Santo Domingo, dépérit et compte 125 000 habitants, dont seulement 15 000 esclaves. |
|
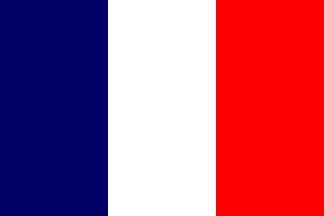 |
Le sort de l'île est bouleversé par la Révolution française. Le 15
mai 1791, à Paris, l'Assemblée nationale accorde timidement le droit de
vote à certains hommes de couleur libres. Cette demi-mesure inquiète les
colons blancs de Saint-Domingue qui songent à proclamer leur
indépendance. Elle ne satisfait pas davantage les affranchis. Les uns et
les autres s'affrontent violemment. |
|
| Haïti | 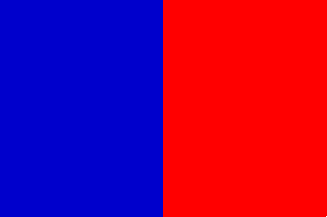 |
Le
18 mai 1803, lors du congrès de l'Arcahaie, regroupant
l'ensemble des chefs de la Révolution haïtienne,
Jean-Jacques Dessalines arracha du drapeau tricolore français la
partie centrale de couleur blanche, pour lui symbole de la race blanche et non pas
de la royauté,. Catherine Flon, prit les deux
morceaux restants, le bleu et le rouge et les cousut ensemble pour
symboliser l'union des noirs et des mulâtres et créa le
drapeau de la République d'Haïti. Jean-Jacques Dessalines, élu président, rendit à l'île son ancien nom d'Haïti. Il fit procéder à l'extermination méthodique des Blancs, et se comporta en tyran capricieux et violent, se fit couronner empereur sous le nom de Jacques ler (8 octobre 1804) suivant en cela Napoléon Ier (18 mai 1804), |
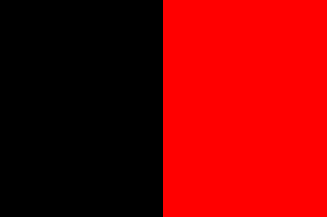 |
Le 20
mai 1805, l'empereur Jacques Ier radicalisa son drapeau et
remplaça le bleu par le noir. Le noir symbolisait mieux la
population noire, le support du régime. Il fut assassiné le 17 octobre 1806. Christophe s'empara aussitôt du pouvoir; après une lutte acharnée contre Pétion, son rival mulâtre, il resta maître de la plus grande partie de l'île dans le Nord, et prit en 1811 le titre de roi, sous le nom de Henri Ier. |
|
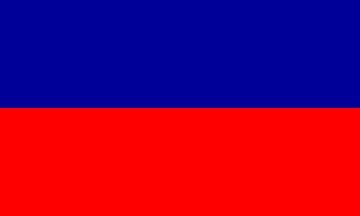 |
Alexandre
Pétion conserva néanmoins jusqu'à sa
mort la partie Sud de l'île et y maintint le gouvernement
républicain. Le drapeau républicain modifia les bandes
bleue et rouges en les positionnant horizontalement. L'économie haïtienne, fondée sur l'exportation du sucre et du café, est obligé de se reconvertir à l'autarcie et à l'agriculture de la subsistance. |
|
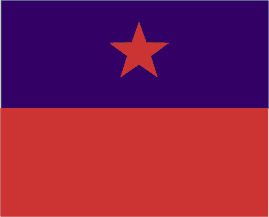 |
Le département du Sud fit secession entre 1810 et 1812 sous la direction du général mulâtre André Rigaud. Une étoile rouge particularisait son drapeau. | |
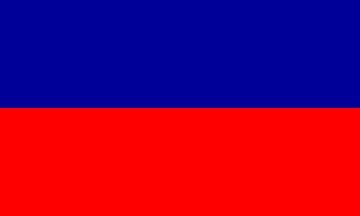 |
Christophe périt dans une insurrection militaire en 1820. Alors Jean-Pierre Boyer,
qui avait succédé en 1818 à Pétion dans le gouvernement du sud, fut
proclamé président. Il soumit la partie espagnole en 1822 et devint
maître de toute l'île. La France reconnait la République d'Haïti en 1825, mais elle stipula une indemnité de 150 millions en faveur des anciens colons expropriés. Cette indemnité fut une charge écrasante que la jeune république ne put supporter. Elle subit de graves crises financières. Boyer se maintint au pouvoir durant vingt-cinq années. Ses perpétuels conflits avec la Chambre des représentants finirent par amener sa chute. D'abord vainqueur de son adversaire, Hérard Rivière, il succomba en face d'une insurrection qui éclata en février 1843. Il s'enfuit à la Jamaïque, puis en France, où il mourut (1850). Après quelques mois d'anarchie, Rivière fut élu président (décembre 1813) et on vota une constitution imitée de celle des États-Unis (La constitution de 1787). On décida que seuls les Africains et les Indiens pourraient jouir de droits politiques et posséder des propriétés foncières. |
|
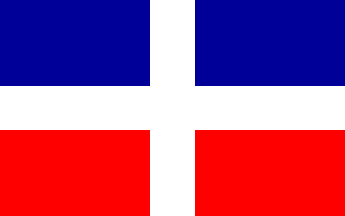 |
Sur ces entrefaites, en 1844, la région orientale, l'ancienne colonie espagnole, qui refusait de participer au paiement de l'indemnité allouée aux anciens colons français, se sépara de Haïti. Elle ajouta une croix blanche au bicolore haïtien et pris le nom de République Dominicaine. Le premier drapeau dominicain fut confectionné par Maria Trinidad Sanchez. | |
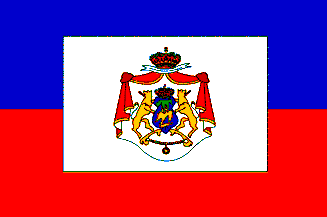 |
Après une succession de gouvernements plus ou moins provisoires, Soulouque devient président en 1847. Ce dernier se fit proclamer empereur en 1849 sous le nom de Faustin Ier. Il fut renversé en 1859, et la république fut rétablie sous la présidence de Geffrard. | |
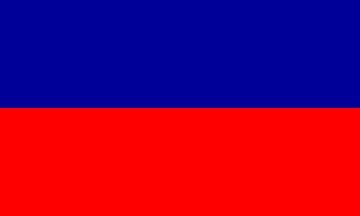 |
Le drapeau civil (le plus répandu) fit l'objet d'un incident aux Jeux Olypique de 1936 avec le Liechtenstein qui possédait un drapeau identique et qui fut obligé de le faire évoluer. | |
 |
François Duvalier est élu président en 1957 et prends tous les pouvoirs en 1960. Le 25 mai 1964, le drapeau rouge et noir est restauré. Duvalier meurt en 1971. Son fils Jean Claude lui succède. |
|
 |
1986: Les
Duvalier sont chassés. C'est le retour à la
démocratie et l'adoption du drapeau national bleu et rouge avec
l'emblème. L'emblème d'Haïti est composé d'un palmier (palmiste plus exactement) couronné d'un bonnet phrygien aux couleurs du drapeau national. Au pied du palmier on peut voir un tambour et au-dessus, trois fusils à baïonnettes de chaque côté du palmier, le même nombre de drapeaux et divers armements entourent le palmier, notamment deux canons de chaque côté. Dans la partie inférieure, sur une ceinture d'argent, on peut lire la légende en français :« L'union fait la force », bien que la devise nationale soit « Liberté, Égalité, Fraternité ». L'emblème original date de 1807. |
|
|
Les illustrations sont des
photographies de l'auteur ou proviennent de FOTW et des sites indiqués
sur la page.
https://www.herodote.net/1492_a_1804-synthese-174.php http://www.cosmovisions.com/ChronoHaiti.htm |
||