Sanary
(Sud Ste Baume)
.
|
Bandol
Sanary (Sud Ste Baume) |
||
|
. |
||
 |
 |
|
 |
La communauté de communes se transforme en communauté d'agglomération le 1er janvier 2015. | |
. |
||
 |

En 1751, Bandol reçut de son seigneur, Ange Boyer de Foresta, ses armoiries frappées de l'étoile d'or sur champ d'azur avec pour devise : dux et navigantium securitas. Ces armoiries sont identiques à celles d'Istres. |
L'antique
"Bandolum" n'est cité que vers 1200 : "Bendoroi". Seigneurie
de l'abbaye de Saint-Victor, puis des Boyer.
Construction du fort de Bendor au 17ème par le duc d'Epernon. Henri IV le donna au capitaine Boyer en récompense de services rendus. Habile commerçant et meneur d'hommes, Antoine Boyer de Foresta obtint, en 1603, le monopole de la pêche au thon, à la madrague, sur toute la côte depuis La Ciotat jusqu'à Antibes. Possession des seigneurs de la Cadière-d'Azur et, à ce titre, administré par les consuls de la ville, c'est le 8 janvier 1715 que l'arrière-fief de Bandol, sous l'impulsion de son seigneur François Boyer de Foresta, finit par obtenir la séparation définitive de Bandol et du fief de la Cadière-d'Azur. Au début du XIXème siècle, le thon, devenu rare, ne pouvait plus faire la fortune de Bandol, toute une industrie du vin vit le jour et le port de Bandol, retentit du trafic ininterrompu de ses tartanes bourrées, jusqu'au pont, de barriques de vin. |

Le drapeau de la ville : blason sur fond or. |
||
|
Sanary sur Mer (17177
h)
San Nari |
d'azur à une tour d'argent sommée d'une croisette du même, la tour maçonée de sable, ajourée d'une porte, et de deux lucarnes de même et côtoyée de deux palmes d'or, les tiges passées en sautoir
De Bresc dans son armorial indique un croissant plutôt qu'une croisette. |
En 1079,
les moines de Saint-Victor de Marseille possédaient la
"cellam
Sancti Nazarii". Celle-ci est citée également en
1113
(bulle de Pascal II) et en 1135 (bulle d'Innocent II).
Saint Nazaire, natif de Milan, était un des saints honorés par les moines de Saint-Victor de Marseille installés à Six-Fours. Le terroir était de la dépendance des vicomtes de Marseille, puis par suite de mariage, des comtes de Vintimille (1727). Le hameau de Saint-Nazaire prit son nom de la "cella". C'est autour de celui-ci que s'installèrent des pêcheurs et des paysans ; ce fut un hameau, puis un bourg dépendant d'Ollioules. L'an 1663, le 23 juin, au bourg de Saint-Nazaire, les syndics du lieu passèrent une transaction avec François de Vintimille des comtes de Marseille, leur seigneur. Cette transaction par laquelle le seigneur de Vintimille s'engageait à tout faire pour obtenir la séparation d'avec Ollioules, fut faite avec des garanties diverses pour le bourg. Entre autres, droit du port du chaperon pour les consuls élus, emploi des armoiries du seigneur pour celles du bourg, etc. Le seigneur proposa qu'autour des armoiries viendrait s'inscrire la mention « Saint-Nazaire - Beauport » Hélas rejetée, la tentative de séparation n'obtint pas de succès. La transaction fut donc annulée à Aix. Les armoiries proposées ne purent être adoptées. Mais les syndics, le seigneur, les habitants, leurs amis s'entêtèrent et malgré les ordres du Roi, on refit une demande en séparation. Colbert, principal opposant étant mort, le Roi Louis XIV finalement par arrêt en date du 10 juillet 1688 donna son consentement. En septembre, on entreprit de limiter le terroir accordé à Saint-Nazaire, fixé au tiers du terroir total d'Ollioules. Pour en marquer les limites, deux experts venus d'Aix, restèrent à Saint-Nazaire pendant un mois et demi, marquant par des termes et des marques gravées sur des roches les nouvelles limites. Sur les deux termes furent gravées « une tour sur deux palmes et une croix au-dessus ». C'étaient les nouvelles armoiries qu'avaient choisi les nouveaux consuls. Plus tard, en 1697, ce sont ces armoiries qui furent déposées à la Recette des Droits d'enregistrement des armoiries, créée par édit du mois de Novembre 1696 du Roi Louis XIV. C'est monsieur de Cuges, de la Tourelle, trésorier de la communauté qui en fit le dépôt. Le montant des droits s'éleva à 20 livres. La tour romane construite en 1300 résista à plusieurs attaques, notamment en 1707 à un siège du duc de Savoie. Le bourg garda son nom jusqu'en 1890 où, par décret, il prit le nom de Sanary, ce qui signifie San Nari en provençal. Port de commerce depuis l'époque romaine, Sanary le demeura jusqu'à la fin du 19ème avec des fortunes diverses ; aujourd'hui port de plaisance apprécié. |
 Pavillon des Pointus de Sanary sur Mer. |
||
 Drapeau municipal |
||
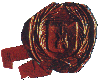
Seau de San Nari |
||
|
Les blasons et drapeaux
proviennent des sites indiqués dans la page ou de photos de
l'auteur.
|
||