.
|
Ventoux
- Comtat Venaissin (Sud)
|
||
|
.
. |
||
|
Le District Urbain de Carpentras est créé en 1966. Son premier président est Maurice Charretier, maire UDF de Carpentras.
En 1967, il est renommé District du Comtat Venaissin. Le district crée une usine de traitement de déchets, un aérodrome et un camping. Le 26 décembre 2001, le district se transforme en Communauté de Communes Ventoux - Comtat Venaissin (la CoVe). |
 |
|
 logo 2016 http://www.lacove.fr/accueil.html/ |
2003: Transformation en Communauté
d'Agglomération
Ventoux - Comtat Venaissin qui comporte 25 communes pour 60 597 h du Vaucluse.. voir partie est et partie ouest |
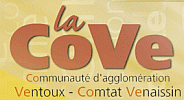 |
. |
||
|
Carpentras (28 309 h)
|
 De gueules, à un mors antique de cheval d'argent, dont le milieu est forgé d'un des clous de la passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ La mère de l'empereur Constantin aurait fait forger un mors pour le cheval de son fils avec un clou de la croix du Christ. Conservé à Sainte-Sophie de Constantinople, le saint mors en disparut lors du pillage de la ville par les croisés en 1204... pour réapparaître dès 1260 à Carpentras dans la cathédrale de Saint Siffrein (XIIIe siècle).  L'Office de Tourisme affirme qu'il figure sue les armoiries des évêques de Carpentras depuis 1226 et qu'il est l’emblème de la ville depuis 1260.   |
Les
formes
attestées les plus anciennes sont Carbantorate au 1e
siècle,puis Carpentoracte Meminorum qui devint Forum Neronis
(Marché de Néron) sous Tiberius Claudius Nero. La
cité reprend son nom de Civitas Carpentoratensium au IVe
siècle pour devenir Carpentoratensium monast., en 896. Elle
est
orthographiée Carpentoracte au Moyen-Âge, puis
Carpentràs selon la norme classique de l'occitan ou
Carpentras
selon la norme mistralienne. Son étymologie est à
rattacher au celte carbanto (char) et rate
(forteresse). Le
rôle initial de cette cité était donc
d'être
une forteresse qui surveillait le passage des chars sur le
gué
de l'Auzon. Le pape Clément V établit sa curie à Carpentras en 1313. Lorsqu'il meurt en 1314, son successeur donne sa préférence à Avignon. Cependant, capitale du Comtat Venaissin en 1320, la ville profite de la munificence pontificale : gouvernée par ses évêques, elle s'étend et s'entoure d'une enceinte dont il ne reste plus que la porte d'Orange. Chassés de France par Philippe le Bel, les Juifs se réfugièrent en terres papales où ils étaient en sécurité et bénéficiaient de la liberté de culte. Avec Avignon, Cavaillon et L'Isle-sur-la-Sorgue, Carpentras abrita une importante communauté juive dans un quartier qui ne devint ghetto qu'à la fin du XVIe siècle. Dès 1790, dans l'esprit révolutionnaire, Avignon chasse le vice-légat, représentant l'autorité pontificale et demande son rattachement à la France. Les habitants de Carpentras, en revanche, tentèrent d'établir un petit État indépendant, qui réaliserait chez lui les réformes de l'Assemblée Constituante française, mais sans accepter de le réunir à la France. En avril 1790, sans l'accord du pape, mais en reconnaissant son autorité, ils se réunirent en assemblée et réformèrent le gouvernement : le pape y fut reconnu comme souverain constitutionnel. |
|
D'azur
chargé au premier
franc canton dextre d'un soleil d'or, au premier franc canton senestre
d'un croissant de lune figuré d'argent et en pointe d'une
main
appaumée en pal aussi d'argent.
|
Mazan
est cité en 982 sous le nom de "Villa Madazano", puis
"Maazano" en 1302. Co-seigneurie divisée en deux parties : l'une aux Retronchin, puis aux Sade, l'autre aux d'Astouaud puis aux Vincens. 1562: le bourg est pillé par le baron des Adrets. 1580: la tour du château de Philippe Saignet d'Astouaud est rasée par ordre du Parlement car celui-ci est accusé de complicité dans le meurtre d'un Grimaldi. Épidémies de peste en 1588-1589 et en 1629. Vers 1725 naît le Càrri (le char) de Mazan. Il s'agit d'une journée des revendications accordée au peuple par les deux co-seigneurs et qui se perpétue encore tous les vingt ans. À la fin du XVIIIe siècle est fait à Mazan le premier festival de Provence. Il s'agissait de représentations théâtrales de pièces du marquis de Sade en son château. |
|
 Devise : In manu Dei omnia sunt (Tout tient dans la main de dieu) |
||
 Ce drapeau rouge et vert avec un M jaune n'est pas celuide Mazan, ni de Meaux en Seine et Marne, mais celui de Moudon (Suisse) commune jumelle de Mazan |
||
Sarrians (6 065 h)  http://www.ville-sarrians.fr  ancien logo |
 D'azur à la clef d'or et à la clef d'argent passées en sautoir, accompagnées, en chef, d'une tour donjonnée d'or ouverte du champ, ajourée et maçonnée de sable |
Les
noms
attestés de la commune, Sarrianis (1016), Sarrianis castri
(1023), Sarrianum Villam (1037) et Sarriano (1267) permettent de penser
à une racine sar-ser ayant le sens de colline (lou serre en
provençal) accolée à une seconde
racine ria(is)
signifiant rivière La première agglomération s'appelait Puyricard (Poddium Aicardi). Sarrians est fondé en 968 par le premier comte de Provence, Guillaume le Libérateur qui fonda un monastère bénédictin donné à l'abbaye de Cluny. Vocable révolutionnaire : Marat. |
| Aubignan (5 661 h) http://www.aubignan.fr/ |
 D’argent au bâton et au faisceau de gueules posés en sautoir et à la hache du même, posée en pal brochant, accostée des lettres S et V de sable. (S et V, initiales de Saint Victor, officier romain, patron de la commune, déjà évoqué par le faisceau et hache de licteur). Ces armoiries existent sur les billets de santé de 1722. |
La ville
d'Aubignan aurait été fondée
entre le Ier siécle avant Jésus Christ et le Ier
siecle après Jésus
Christ. Un certain Albanius - qui aurait possédé
son territoire - ayant
donné son nom à la ville. |
 Le blason sur les plaques de rue est plus simple: D’argent à la hache et au faisceau de gueules posés en sautoir. |
||
Loriol-du-Comtat (2 603 h) http://www.loriolducomtat.fr/accueil.html  |
 D'argent au pin terrassé de sinople |
Le 23 juin 1148, des moines cisterciens venant de Mazan dans
l'Ardèche, commencèrent à s'installer
à
Gordes et fondèrent l'abbaye de Sénanque.
Quelques-uns
vinrent sur place pour assécher les marais qui entouraient,
au
quartier de Meyras, le prieuré clunisien de Notre-Dame des
Anges. Ce fief des comtes de Toulouse, marquis de Provence, fut dévolu, en 1240, à Barral des Baux. Un château fut alors édifié sur le Mourre di masco (la colline des sorciers), en 1254. Il fut entouré de silos à grains et de cuves vinaires creusées dans le roc. La plus ancienne dénomination attestée du nom du village date de 1254 avec castr. Aurioli. Cette forme ancienne est dérivée de aureolus, qui désigne le loriot en latin. Le nouveau seigneur accorda, le 1er octobre 1264, une charte de privilèges aux Loriolais. Contre 6 000 sous tournois, payables en trois échéances, ils se voyaient accorder le droit d'élire leurs syndics, de lever des impôts et étaient exonérés de certaines charges. Le recteur du Comtat Venaissin, Nicolà de Franzesi, nouvellement nommé, confisqua son fief à Bertrand des Baux, pour défaut d'hommage. Il ne lui fut rendu qu'en 1297 après qu'il eut versé 2 000 livres. Le neveu de Clément V, Raymond Guilhem de Budos, seigneur de Clermont et de Lodève, gouverneur de Bénévent et recteur du Comtat Venaissin, épousa, en 1310, Cécile des Baux, dite Rascasse ou Belle Comtesse, qui lui apporta en dot Loriol. Ce fief resta aux Clermont-Lodève jusqu'en 1363, année du mariage de Marguerite de Budos avec Astrorg de Peyre, un des barons du Gévaudan devenu seigneur de Beaumes-de-Venise. Cette famille le conserva jusqu'en 1417. En 1399, une transaction fut signée entre Loriol, Sarrians, Bédarrides et Monteux pour l'entretien et le curage des rivières traversant leurs territoires. Loriol devint Loriol-du-Comtat en 1929. |
| Saint-Didier (2 144 h) http://www.mairie-saint-didier.com/ |
 Ecartelé d'or et de gueules à la croix cléchée, vidée et pommetée de douze pièces de l'un en l'autre adoptée en 1983 |
Le
castrum primitif fut vendu à Franco,
évêque de Carpentras, en 1160, par Raymond V,
comte de Toulouse et marquis de Provence. Ce fut à cette
occasion que, pour la première fois, fut utilisé
le nom de S. Desiderii'. Vocable révolutionnaire : Pierre-Blanche Saint-Didier était anciennement appelé (XIXe siècle) Saint-Didier-les-Bains grâce à ses stations thermales situées sur la commune et à ses demeures d'accueil prestigieuses pour soigner diverses maladies grâce au thermalisme. Le domaine de Sainte-Garde — lieu dédié aujourd'hui aux séminaires catholiques — a servi d'hôpital pendant la Première Guerre mondiale. |
 Sur les plaques des rues, on trouve ce blason présentant une croix cléchée et pommetée bleue sur un fond gravé. |
||
| Venasque (1 012
h) http://www.venasque.fr/ |
 De gueules à la croix vidée, cléchée et pommetée d'or C'est le blason utilisé actuellement par la commune. Une forte ressemblance avec le blason de l'occitanie. |
Venasque
faisait partie du territoire des Memini, tribu gauloise dont le
chef-lieu était Carpentras (Carpentorate Meminorum).
L'archéologie et la toponymie montrent que Vindasca fut
l'une des principales places fortes de cette tribu. L'histoire de Venasque suit celle du comtat Venaissin. En 1125 il devient la propriété des comtes de Toulouse. En 1219 le comte de Toulouse Raymond VII étant allié des Albigeois, vaincus par les troupes du pape et celles du roi de France, dut céder le comtat au pape. Le Comtat resta aux papes jusqu'au 14 septembre 1791, date à laquelle il fut réuni à la France. |
 D'or à la croix vidée, cléchée et pommetée d'azur C'est le blason que l'on voit sur les plaques des rues. Il correspond aux armoiries de la maison de Venasque et était l'ancien blason de la commune. |
||
| La Roque-sur-Pernes (415
h) |
 D'azur à la colombe huppée essorante d'argent, becquée et onglée de gueules, le pied dextre levé, accompagnée de sept étoiles d'or, quatre en chef et trois en pointe. adoptée en 1940 Armes des Seguins. |
Plus
vieille référence en 1113 : La Rocha, en 1319, Rocca Supra Paternas. Lorsqu'en 1274 tout le Comtat fut cédé à la papauté, il fut inféodé à divers Seigneurs, la plupart italiens. Co-seigneurie des Pérussis , des Séguin , des Galléan de Gadagne et enfin des Centenier. Dans la nuit du 10 décembre 1573, Les religionnaires de Ménerbes, avec l'aide de ceux de Joucas, s'emparèrent du village. Ils en repartirent six jours après, traînant derière eux une caravane de cent mulets chargés de butin, de soixante bœufs et de trois cent cochons. |
Le Beaucet (351
h) http://www.lebeaucet.com/fr/ |
 De gueules aux trois besants d'argent, au chef d'or. Armes de Geoffroi de Vairols, évêque de Carpentras (1347-56). adopté le 25 juin 1977 |
Le
nom de Beaucet vient de Baus, en provençal « la
falaise ». Son emplacement stratégique dans les
Monts de Vaucluse permet de surveiller les alentours. Le Beaucet est
cité en 1160 sous les noms de Balcium et Beaucetum. La Seigneurie des évêques de Carpentras, est passée aux Gualteri de 1690 à la Révolution. Le 16 mai 1127, à la mort de Saint Gens, son corps est déposé près d'un rocher au cœur du vallon où une chapelle romane sera élevée vers le milieu du XIIe siècle. Au XVIIe siècle, ses reliques sont transportées dans l'église du Beaucet. Le château, construit pour être une forteresse des terres du comte de Toulouse, puis de l'État pontifical, possède quatre tours crènelées. Il résiste, en 1573, aux attaques des troupes réformées qui dévastent alors la chapelle Saint-Étienne, située hors les murs. Le château est restauré au XVIIe siècle. En 1690, en raison des trop importants frais d'entretien qu'il nécessite, le cardinal Marcel de Duras cède le château à François de Gualtéri, qui adjoint le nom du village à son patronyme. En 1784 le château est à nouveau détruit par un incendie provoqué par la foudre. Il ne reste depuis, que des ruines. |
|
Les illustrations sont des
photographies de l'auteur, proviennent des sites indiqués sur la page ou viennent de http://fr.wikipedia.org ou Heraldry of the world
|
||